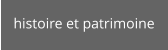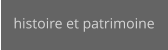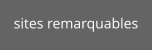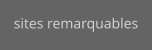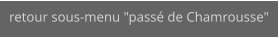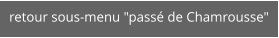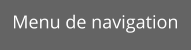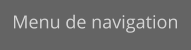© chamrousse.info 2006-2024 - Site non commercial édité par l’Association CHA’mrousse - plan du site - mentions légales


Julien
Arsène
Tasse,
dit
le
Père
Tasse
,
était
sarthois
de
naissance
mais
dauphinois
d'adoption.
Il
naquit
dans
le
petit
village
de
Vancé
le
29
août
1823
"
à
deux
heures
du
soir
".
C'était
le
5ème
et
dernier
enfant.
Le
16
février
1826,
sa
jeune
mère
décède
à
l'âge
de
31
ans
(le
petit
Julien
n'a
que
deux
ans
et
demi).
Le
10
mai
1830,
son
père
se
remarie
avec
une
"
domestique
à
gage
"
de
15
ans
sa
cadette.
Les
relations
avec
sa
belle-mère
furent
détestables
et
c'est
à
l'âge
de
14
ans
qu'il
quitta
Vancé
pour
faire
son
tour
de
France
comme
compagnon
sabotier
(métier
que
lui
enseigna
son
père),
en
passant
par
Saumur
où
il
fut
accueillit
par
un
oncle
maternel.
Enfin,
ses
pas
l'amenèrent
à
Grenoble
où
il
continua
la
fabrication
des
sabots.
Dans
la
capitale
des
Alpes,
il
exerça
aussi
le
rôle
de
mandataire
entre
les
parents pauvres et les nourrices de la campagne auxquelles leur étaient confiés les enfants.
Le
Père
Tasse
va
gagner
sa
célébrité
en
s'installant
à
Roche-Béranger
dès
1863,
avec
sa
compagne
et
ses
deux
garçons.
Il
a
alors
40
ans.
Il
y
édifie
une
fromagerie,
bientôt
transformée
en
un
chalet
servant
de
refuge
et
de
restaurant.
Il
y
restera
22
années
au
cours
desquelles
il
accueillera
nombre
de
visiteurs
illustres.
L'heure de la retraite sonne alors qu'il a 62 ans et il prend possession d'une humble demeure à Saint-Georges d'Uriage. Il s'éteignit à Grenoble le 10 janvier 1898.
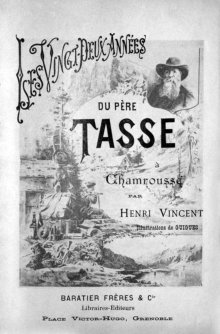
Henri
Vincent
a
publié
en
1891
les
vingt-deux
années du Père Tasse à Chamrousse
.
Ouvrage restauré numériquement par Alain Coïc.
Vous pouvez le télécharger gratuitement
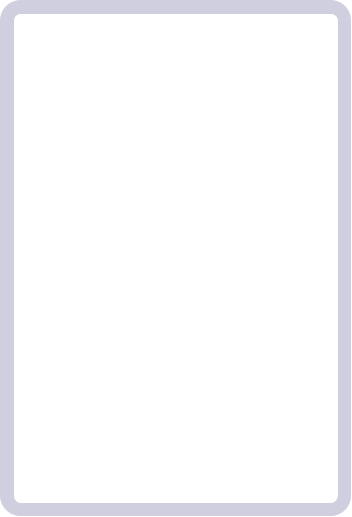
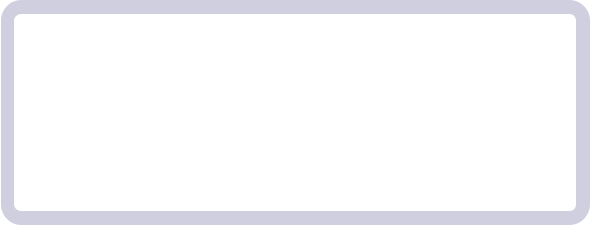

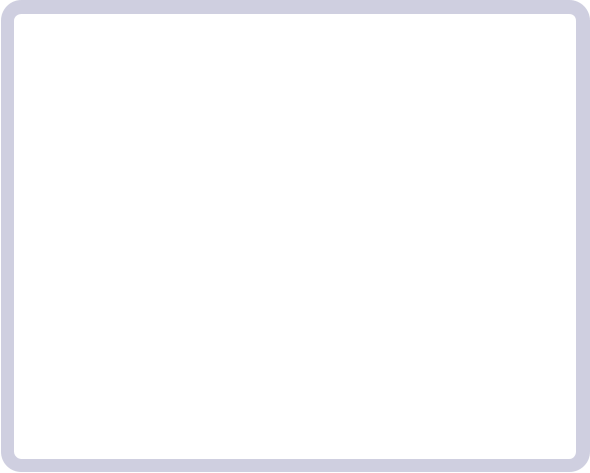
Julien,
dernier
né
de
cinq
enfants
de
la
famille
Tasse,
vit
le
jour
en 1823 ainsi que l'atteste son acte de naissance.
Ses
aînés
furent
Madeleine
(née
en
juillet
1814),
Elisabeth
(avril
1816),
Martin
(septembre 1818) et
Louis
(avril 1821).
L'histoire
du
Père
Tasse
ne
révèle
pas
s'il
continua
à
avoir
des
relations
avec
sa
famille,
une
fois
installé dans l'Isère.

Vancé, le village natal du Père Tasse

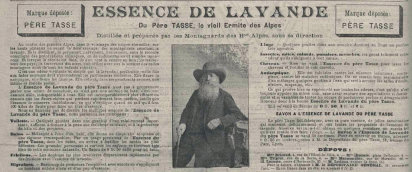
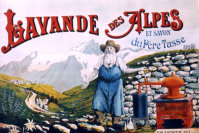
Ci-dessus,
deux
"réclames"
parues
respectivement
en
décembre
1895
et
de
janvier
à
mars
1896
dans
la
revue
Le
Progrès Illustré
.
Le
Père
Tasse
s'était
lancé
dans
les
affaires
avec
la
fabrication
d'essence
de
lavande
et
des
savons
.
A
en
croire
la
publicité,
sa
lavande
était
quasi
universelle
puisqu'elle
servait
à
la
toilette,
aux
bains,
aux
frictions,
au
shampoing.
Elle
était
même
censée
lutter
contre
les
migraines,
les
insectes
(mites,
cafards...)
et
était
antiseptique !
On
remarquera
que
le
dessin
représentant
le
Père
Tasse
dans
ces
publicités
est
exactement
le
même
que
celui
qui
illustrait l'ouvrage le concernant.
en savoir davantage sur le Père Tasse
- sa biographie
- son chalet
- les personnages célèbres qui ont fréquenté son gîte
ci-dessus, une autre
publicité tout en couleur sur
la lavande des Alpes & le
savon du Père Tasse
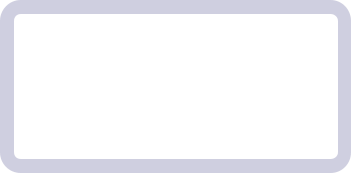
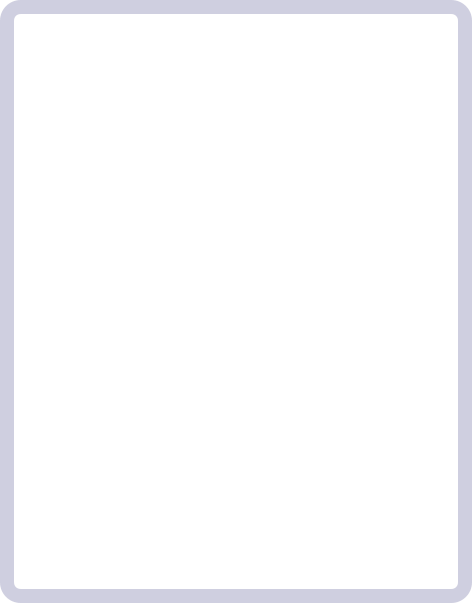
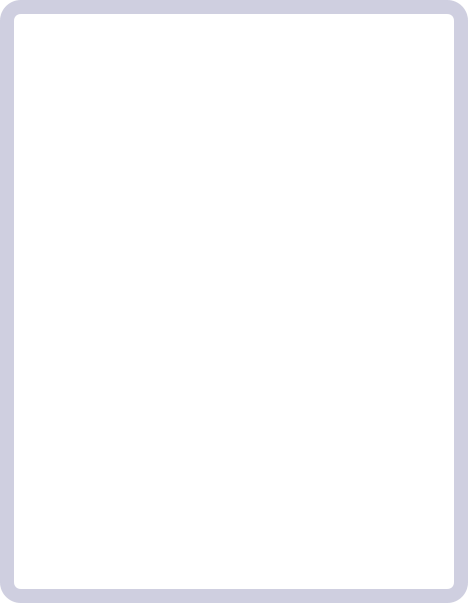
le saviez-vous ?
le Père Tasse vu par Alexandre Bibesco
Le
Père
Tasse
sollicita
à
trois
reprises
le
Conseil
Général
de
l’Isère
(*)
afin
d’obtenir des
subventions
pour son chalet :
en
1874
:
le
CG
lui
octroya
500
fr.
dans
sa
séance
du
7
novembre
(à
une
voix
de
majorité).
Pour
justifier
la
demande
du
«
sieur
Tasse
(Arsène)
»
il
était
expliqué
que
son
chalet
«
pour
rendre
les
services
qu’on
en
attend,
doit
être
agrandi
et
distribué
de
manière
à
séparer
au
moins
le
dortoir
de
la
salle
à
manger
;
l’ameublement
doit
être
aussi
augmenté.
Mais
ces
diverses
dépenses
sont
au-dessus
des
ressources
du
propriétaire
qui
y
a
déjà
consacré
tout
ce
dont
il
pouvait
disposer
».
Dans
le
rapport
remis
au
CG,
il
était
ajouté
que
«
ce
chalet
se
trouve
à
proximité
du
sommet
de
Champ-
Rousse,
à
deux
mille
mètres
d’altitude,
sur
le
chemin
que
prennent
non-
seulement
les
touristes
et
les
géologues
ou
botanistes
…,
mais
encore
les
pâtres,
les
charbonniers
et
les
bûcherons…
».
Ce
même
rapport
donnait
lecture
d’une
délibération
du
conseil
municipal
de
Vaunaveys-le-Haut
:
l’utilité
et
les
ressources
que
ce
chalet
offre
aux
voyageurs
sont
incontestables
et
que
déjà
il
a
rendu
de
nombreux
services
à
plusieurs
touristes
et
travailleurs
indisposés
…
En
outre
le
conseil
atteste
«
la
parfaite
moralité
et
l’honorabilité
du
sieur
Tasse
et
de
sa
famille,
dont
M.
le
Maire
de
Vaulnaveys se plaît à reconnaître le dévouement
».
en
1878
,
le
CG
fut
insensible
à
la
demande
du
Père
Tasse
qui
sollicitait
«
un
nouvel
encouragement
pour
l’amélioration
du
chalet
».
Il
la
rejeta
donc
estimant
qu’
«
il
a
été
assez
fait
par
la
subvention
de
500
fr.
»
de
1874
et
qu’il
n’y
a
«
pas
lieu
d’intervenir
dans
cette
question
et
qu’il
faut
la
laisser
à
l’industrie privée »
.
en
1883
,
ultime
sollicitation
du
Père
Tasse
qui
souhaitait
une
subvention
de
500
fr.
Le
CG
rejeta
sa
demande
car
«
le
sieur
Tasse
exploite
un
établissement
dont
il
retire
personnellement
tous
les
bénéfices,
s’il
y
en
a
à
retirer,
de
même
il
doit
répondre
à
tous
les
besoins
de
son
installation.
En
un
mot,
il
s’agit
d’une
propriété
privée
dans
laquelle
il
faut
éviter
d’intervenir
par
une allocation sur les fonds publics….
».
(*) sources : délibérations du CG de l’Isère, BnF
Le
père
Tasse
qui
tient
ce
chalet
est
un
Vieux
de
la
Montagne
(moins
les
instincts
sanguinaires
et
criminels)
qui
a
planté
son
jardin
et
sa
cabane
depuis
quinze
ans
au
pied
de
la
croix
;
il
monte
à
la
fin
de
mai
et
ne
descend
qu'en
novembre
pour
achever
d'assembler,
dans
la
vallée,
l'hiver,
les
deux
bouts qu'il a tant de peine à rattraper l'été.
Il
souffre,
plus
qu'on
ne
croit,
non-seulement
des
caprices
d'une
saison
peu
fructueuse,
mais
de
la
violence
de
certaines
intempéries
encore
fréquentes
à
2,000
mètres
de
hauteur
;
une
fois
au
déclin
de
la
saison,
une
neige
intempestive
a
failli
le
surprendre
et
le
condamner
à
mourir
de
faim
là-
haut,
lui
et
sa
femme
,
parce
qu'enfin,
il
faut
bien
le
dire,
notre
ermite
est
marié.
Le
père
Tasse
est
philosophe.
Quoique
peu
chanceux,
il
ne
se
plaint
guère.
Et
pourtant,
est-il
possible
de
rencontrer
de
meilleurs
lits,
de
plus
excellent
lait,
des
fleurs
plus
fraîches
à
pareille
altitude
?
Est-il
possible
de
trouver
visages
plus
complaisants
et
mieux
disposés
à
vous
contenter
que
ceux
de
ce
couple
?
Pourquoi
ne
chercherait-on
pas
à
améliorer
la
position
de
cet
ermite
qui
a
rendu
tant
de
services
aux
touristes
?
Pourquoi
les
quatre
communes,
ses
copropriétaires,
ne
passeraient-elles
pas
avec
lui
un
bail
emphytéotique,
basé
comme
ce
genre
de
contrats,
sur
la
longue
durée
de
la
location
et
la
modicité
de
la
redevance,
bail
qui,
en
diminuant
les
charges
de
l'emphytéote,
lui
permettrait
de
s'agrandir
et
de
prospérer
?
Que
ma
voix
soit
écoutée,
et
puisse
le
délicieux
vin
de
Collioure
que
j'ai
bu
chez
lui,
lui
porter
bonheur !
Ce
texte
est
issu
du
chapitre
VII
(coup
de
crayon
Champroussien)
de
l’ouvrage
Delphiniana,
bibliothèque
du
touriste
en
Dauphine
,
écrit
par
le
Prince
Alexandre
Bibesco
(qui
fréquenta
à
plusieurs
reprises
le
chalet
du
Père Tasse), paru en 1888.
Il
s’agit
d’une
correspondance
du
4
août
1879,
adressée
à
Xavier
Drevet,
directeur
du
journal
le
Dauphiné.
L’auteur
a
précisé
en
addenda
«
J'apprends
à
l’instant
que,
depuis
cette
année
(1887),
le
chalet
de
Roche-Bérenger
a
passé en d’autres mains
»


Julien
Arsène
Tasse,
dit
le
Père
Tasse
,
était
sarthois
de
naissance
mais
dauphinois
d'adoption.
Il
naquit
dans
le
petit
village
de
Vancé
le
29
août
1823
"
à
deux
heures
du
soir
".
C'était
le
5ème
et
dernier
enfant.
Le
16
février
1826,
sa
jeune
mère
décède
à
l'âge
de
31
ans
(le
petit
Julien
n'a
que
deux
ans
et
demi).
Le
10
mai
1830,
son
père
se
remarie
avec
une
"
domestique
à
gage
"
de
15
ans
sa
cadette.
Les
relations
avec
sa
belle-
mère
furent
détestables
et
c'est
à
l'âge
de
14
ans
qu'il
quitta
Vancé
pour
faire
son
tour
de
France
comme
compagnon
sabotier
(métier
que
lui
enseigna
son
père),
en
passant
par
Saumur
où
il
fut
accueillit
par
un
oncle
maternel.
Enfin,
ses
pas
l'amenèrent
à
Grenoble
où
il
continua
la
fabrication
des
sabots.
Dans
la
capitale
des
Alpes,
il
exerça
aussi
le
rôle
de
mandataire
entre
les
parents
pauvres
et
les
nourrices
de
la
campagne
auxquelles leur étaient confiés les enfants.
Le
Père
Tasse
va
gagner
sa
célébrité
en
s'installant
à
Roche-Béranger
dès
1863,
avec
sa
compagne
et
ses
deux
garçons.
Il
a
alors
40
ans.
Il
y
édifie
une
fromagerie,
bientôt
transformée
en
un
chalet
servant
de
refuge
et
de
restaurant.
Il
y
restera
22
années
au
cours
desquelles
il
accueillera
nombre
de
visiteurs
illustres.
L'heure
de
la
retraite
sonne
alors
qu'il
a
62
ans
et
il
prend
possession
d'une
humble
demeure
à
Saint-Georges
d'Uriage. Il s'éteignit à Grenoble le 10 janvier 1898.
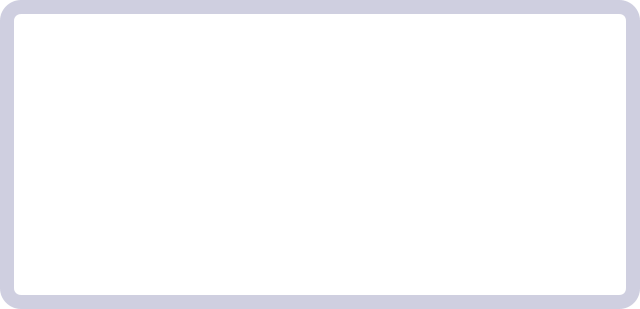
Julien,
dernier
né
de
cinq
enfants
de
la
famille
Tasse,
vit
le
jour
en
1823
ainsi
que
l'atteste son acte de naissance.
Ses
aînés
furent
Madeleine
(née
en
juillet
1814),
Elisabeth
(avril
1816),
Martin
(septembre 1818) et
Louis
(avril 1821).
L'histoire
du
Père
Tasse
ne
révèle
pas
s'il
continua
à
avoir
des
relations avec sa famille, une fois installé dans l'Isère.

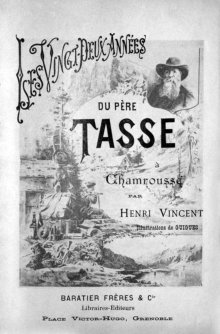
Henri
Vincent
a
publié
en
1891
les
vingt-deux
années
du
Père Tasse à Chamrousse
.
Ouvrage restauré
numériquement par Alain Coïc.
Vous pouvez le télécharger
gratuitement
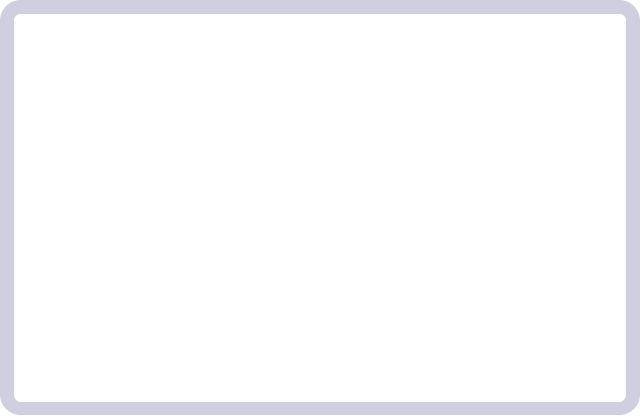


© chamrousse.info 2006-2024 - Site non commercial
édité par l’Association CHA’mrousse - plan du site -
mentions légales